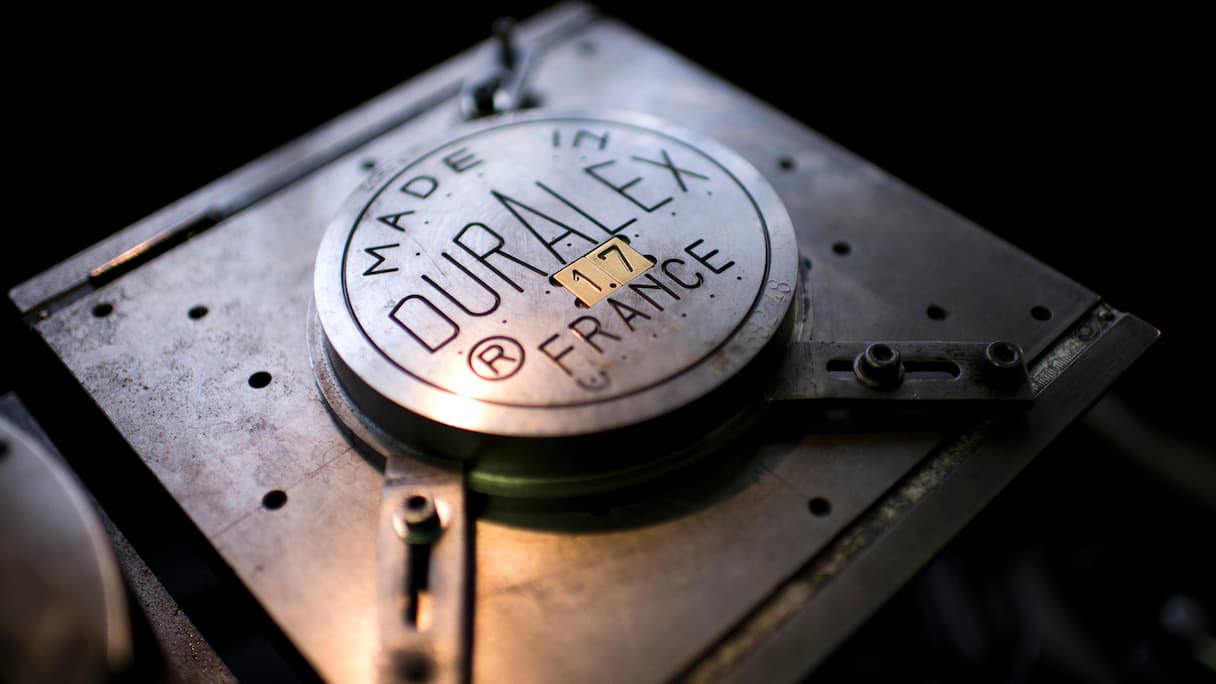[ad_1]
Prêt depuis le 22 décembre et plusieurs fois repoussé – pour cause de remaniement, crise agricole… -, le très attendu rapport Langreney sur l’assurabilité des risques climatiques en France a enfin été officiellement remis, ce mardi, à ses commanditaires : Bruno Le Maire et Christophe Béchu, les ministres de l’Economie et de la Transition écologique.
Face au coût croissant des catastrophes naturelles, comme les inondations qui ont de nouveau touché plusieurs régions de France durant le week-end de Pâques, et face à la crainte d’un retrait des assureurs des régions les plus vulnérables, ce document de 116 pages propose de nombreuses pistes, parfois radicales. Son objectif : améliorer et pérenniser le régime français d’indemnisation des catastrophes naturelles (« cat nat »). Mais aussi prévenir et atténuer les conséquences des sinistres d’origine naturelle.
70 milliards d’euros
Car il y a urgence. L’augmentation de l’intensité et de la fréquence des événements climatiques pourrait se traduire, en France, par 70 milliards d’euros de coûts d’indemnisation additionnels ces trois prochaines décennies, selon le gouvernement. De quoi déstabiliser le régime public privé « cat nat », un modèle envié par de nombreux pays mais en déficit chaque année depuis 2015.
Le Premier ministre s’est emparé du sujet. « Nous ferons évoluer le régime de catastrophe naturelle pour le moderniser », a-t-il annoncé fin janvier, dans sa déclaration de politique générale. Le rapport Langreney sera l’une des bases de travail de l’exécutif, notamment dans le cadre du troisième Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC), en préparation.
« Nous voulons consolider durablement le régime des catastrophes naturelles et cela passe par la responsabilisation de tous les acteurs : assureurs, Etat et collectivités territoriales, particuliers et entreprises », explique en avant-première aux « Echos » l’un des trois coauteurs, Thierry Langreney. « Nous nous sommes efforcés de présenter des préconisations pragmatiques, financées et équilibrées en termes d’efforts, pour toutes les parties prenantes », ajoute l’actuel président de l’association environnementale Ateliers du futur et ancien directeur général adjoint de Crédit Agricole Assurances.
· Augmenter la prime « cat nat » chaque année
Le gouvernement a déjà anticipé l’une des principales conclusions du rapport. Fin décembre, il a décidé d’augmenter la part des primes d’assurance dommages des particuliers et des entreprises consacrée au financement du régime « cat nat », pour dégager 1,2 milliard d’euros de ressources supplémentaires par an. En assurance habitation, la surprime va passer de 12 % à 20 % en 2025, soit un surcoût annuel moyen de 16 euros par foyer.
Pour cette première revalorisation en 25 ans, les auteurs du rapport préconisaient une hausse supérieure, de 20,7 % en 2025. Ils estiment que les sinistres climatiques vont coûter plus cher que dans les hypothèses de la Caisse Centrale de Réassurance (CRR), la société publique qui prend en charge 50 % de la facture des « cat nat » acquittée par les assureurs.
C’est pourquoi le rapport recommande, au-delà du relèvement à 20 %, « une hausse de 1% par an de la surprime, soit 0,20 point de pourcentage». Cette « indexation » doit permettre de maintenir « un effet constant » face à trois phénomènes : « l’augmentation de la fréquence et de la sévérité des événements climatiques », « l’inflation financière des réparations (pièces détachées et main-d’oeuvre) » et « celle des richesses ». Celle-ci est « liée à la hausse de la valeur des biens assurés, mais aussi au vieillissement de la population qui entraîne des migrations vers des zones côtières ou plus ensoleillées, plus sujettes aux inondations, tempêtes et séismes ».
· Découper la France en zones de risques
Les auteurs proposent la création d’une cartographie unique des risques « cat nat », « validée par une commission gouvernementale ad hoc ». La France serait découpée en zones à risque faible (vert), modéré (orange) ou élevé (rouge). Au-delà des actuels plans de prévention communale, « ce « métazonier » permettrait de sensibiliser les résidents des zones moyennement et fortement exposées à au moins un aléa climatique », avance Thierry Langreney.
· Les résidences secondaires et locatives pénalisées
Au motif que leurs propriétaires ont fait le choix d’investir ou rester dans une zone à risque (bord de mer…), les résidences secondaires et les biens locatifs « seraient sortis du contrôle des primes et des franchises « cat nat ». Celle-ci serait « librement fixée par les assureurs », prône le rapport. Autrement dit, ces propriétaires pourraient voir leur cotisation d’assurance habitation ou propriétaire non-occupant s’envoler – mais pas les locataires -, s’ils ne font pas d’efforts pour protéger leurs biens.
· Travaux de prévention obligatoires
Pour éviter les dommages à répétition, et in fine le retrait des assureurs, les habitants des zones rouges devraient faire obligatoirement des travaux de prévention dans les trois ans après un premier sinistre. A défaut, ils subiraient « un triplement de la franchise pour les sinistres suivants dus au même type d’événement « cat nat » », propose Thierry Langreney. Ce reste à charge est actuellement de 380 euros en cas d’inondation et de 1.520 euros en cas de fissures causées par la sécheresse.
Les ménages devront pas exemple installer des batardeaux, version moderne des sacs de sable contre les inondations. Ou bien réhydrater des sols ou installer de membranes étanches lorsque leur maison est vulnérable au risque de RGA.
Avec un coût estimé « entre 5.000 et 10.000 euros par habitation », ces mesures anti sécheresse « seraient cofinancées par un nouveau fonds de prévention (voir ci-dessous) jusqu’à 75 % ou 80 %, selon les revenus des ménages », estime l’auteur. « Environ 10.000 maisons » pourraient en bénéficier chaque année, sur les quelque 3,3 millions fortement exposées au risque de RGA.
Ces mesures visent à maintenir l’assurabilité des biens vulnérables en zone rouge, sans les sortir du régime « cat nat » et sans modifier le périmètre du régime.
· Nouveau fonds Barnier
Une partie de la surprime « cat nat » est dédiée à la prévention. Sa hausse, en 2025, devrait faire passer de 220 millions à 370 millions d’euros les ressources du Fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit fonds Barnier. Alors que ce dernier est aujourd’hui utilisé pour les travaux d’étude des plans de prévention des communes et très centré sur les inondations, les 150 millions d’euros additionnels seraient consacrés à un fonds additionnel, dédié à la prévention individuelle et incluant le RGA. Cette nouvelle structure serait « dotée d’une personnalité juridique » et cogérée par la CCR et la Direction générale de la prévention des risques.
· Bonus-malus pour les assureurs
Pour financer encore davantage le futur fonds de prévention individuelle, les assureurs seraient mis à contribution, en reversant une part plus ou moins importante de la surprime « cat nat » qu’ils collectent en même temps que les cotisations des contrats habitation de leurs clients. Ce versement serait modulé en fonction de leur part de marché dans chaque zone, mesurée par la CCR.
« Un assureur davantage présent en zone à faible risque contribuerait plus, ce qui amoindrirait sa marge et permettrait de réduire les pertes en zone très risquée », précise Thierry Langreney. Le prélèvement effectué auprès d’une compagnie plus présente en zone rouge serait plus faible, voire négatif. Ce système de bonus-malus est censé éviter que les assureurs fuient les zones les plus exposées au profit des plus sûres.
· Cloner MaPrimeRénov’et la Prévention Routière
Face au maquis des solutions de prévention et des subventions, le rapport préconise de « cloner MaPrimeRénov, en créant une plateforme multicanal qui accueille et oriente les particuliers et petits professionnels vers des diagnostiqueurs (maîtres d’oeuvre, experts en assurance), les financements et les intervenants qui pourront réaliser leurs travaux », annonce Thierry Langreney.
Le dispositif « MaPrimResilience » serait géré par « une association similaire à l’Association Prévention Routière qui excelle dans la sensibilisation du public », ajoute-t-il. Reste à savoir si cette mission reviendrait à l’actuelle Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques.
· Indemniser l’érosion du littoral
Pour le problème spécifique du recul du trait de côte, l’élévation de digues et autres mesures de prévention ne suffira sans doute pas. « Pour ce risque à la survenue certaine mais à un horizon incertain, il faudrait créer un fonds à part, sur la base d’un régime de capitalisation, à financer par une hausse de la surprime « cat nat »», estime Thierry Langreney. Son but : indemniser les propriétaires de maisons menacées, qui devront quitter leur bien.
· Décarboner les réparations
Pour verdir l’assurance et contribuer, même modestement, à atténuer les effets du changement climatique, les auteurs veulent décarboner l’indemnisation des sinistres. Par la généralisation de « bonnes pratiques », un accord de Place ou une réglementation spécifique.
En automobile, l’assureur pourrait « offrir une indemnisation supplémentaire, de l’ordre de 3.000 euros » si son client particulier ou entreprise remplace un véhicule qui finit en épave par un électrique. En cas de panne ou accident, il devrait proposer un véhicule de remplacement électrique.
En habitation enfin, « après un incendie, l’assureur pourrait proposer à son client particulier ou petit professionnel de remplacer sa chaudière au fioul ou gaz par une pompe à chaleur, dont il prendrait en charge le surcoût, compris entre 3.000 et 5.000 euros ».
« Ces mesures coûteront peu aux assureurs, tout en étant porteuses pour le climat, leur politique RSE (responsabilité sociale et environnementale, NDLR] et leur image », estime Thierry Langreney.
Les auteurs du rapport
Le rapport Langreney est le fruit de 61 auditions de plus de 150 personnes, menées par trois personnalités missionnées par les pouvoirs publics : Thierry Langreney, président de l’association environnementale Ateliers du futur et ancien directeur général adjoint de Crédit agricole Assurances, Gonéri Le Cozannet, expert au Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), et Myriam Mérad, directrice de recherche au CNRS. Les trois experts ont rencontré les acteurs du monde de l’assurance (compagnies, réassureurs, experts, agents généraux, courtiers) et leurs fédérations, des syndicats agricoles, des ONG, des représentants de l’Etat et des institutions publiques (Haut conseil pour le climat, CESE….)
[ad_2]
Source link