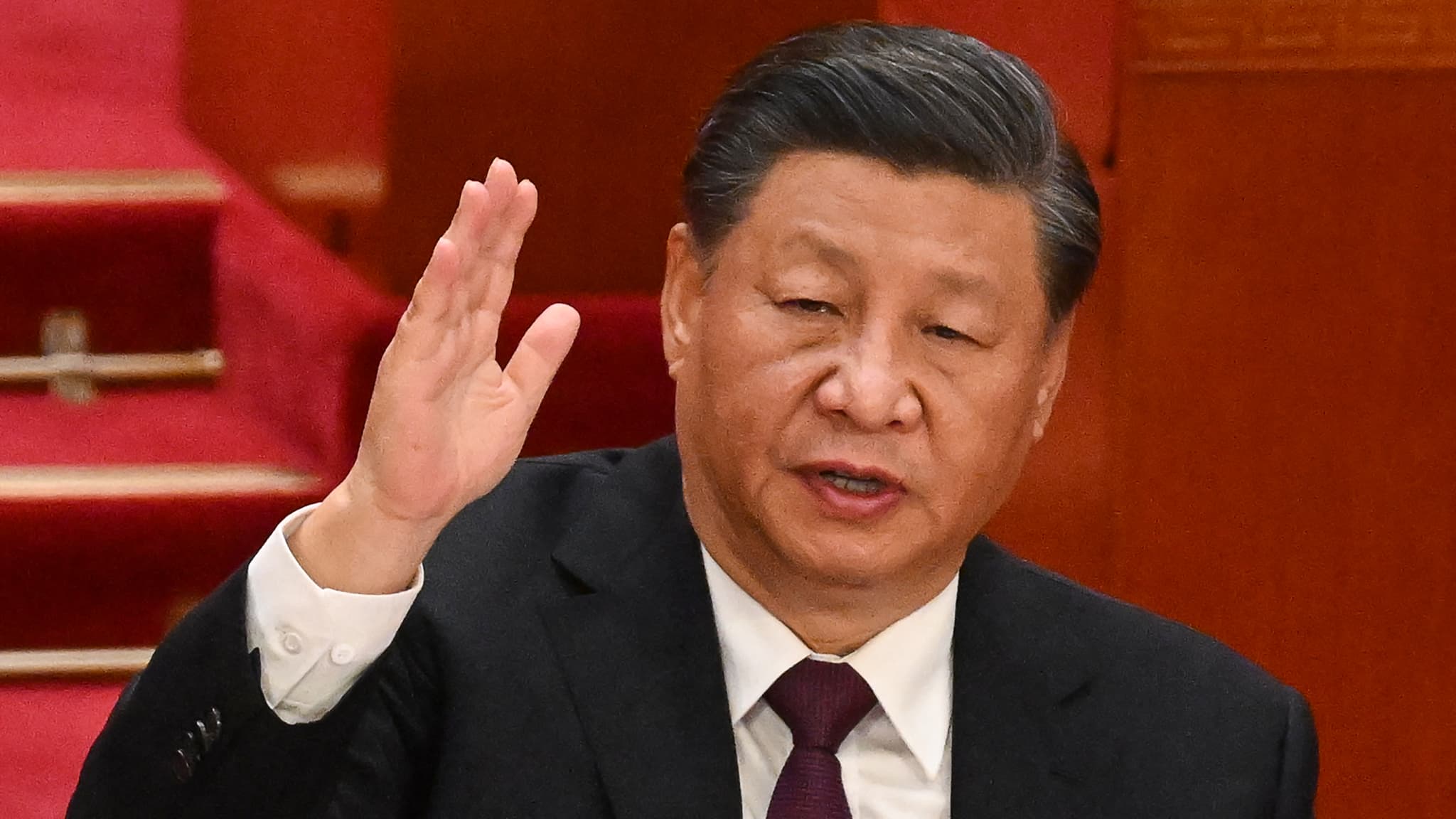[ad_1]
Covid, inflation… Frappée par les crises successives, l’économie de la zone euro patine et voit l’écart se creuser avec les États-Unis dont les performances en matière de croissance ou d’emploi ne cessent de surprendre.
L’histoire se répète. Comme souvent au sortir d’une crise, les États-Unis semblent prendre un peu plus le large face à la zone euro. Pandémie de Covid-19, retour de l’inflation, tensions géopolitiques… D’aucuns pensaient pourtant que les événements récents étaient susceptibles de gripper les rouages de l’économie américaine pour un long moment. Il n’en est rien: après avoir subi quelques turbulences, l’activité outre-Atlantique a rebondi avec une vigueur impressionnante.
Les chiffres publiés ces derniers jours outre-Atlantique ont de quoi faire pâlir les Européens. En 2023, le PIB des États-Unis a progressé de 2,5%. À côté, la zone euro n’a pas vraiment de quoi fanfaronner avec une croissance moindre qu’anticipé l’an passé, à 0,5%, et essentiellement portée par l’Espagne (+2,5%) et, dans une moindre mesure, la France (+0,9%). Première économie du continent, l’Allemagne, elle, a subi un recul de 0,3%.
Infime au début des années 1980, l’écart de richesse entre les États-Unis et l’Europe n’a cessé de se creuser dans les années qui ont suivi. Selon les données de la Banque mondiale, le PIB américain en dollars constants a grimpé de près de 28% depuis la crise financière de 2008. De son côté, l’économie du Vieux continent a crû d’environ 13% sur la période. Aujourd’hui, le PIB par habitant en France, en parité de pouvoir d’achat, est inférieur de 40% à celui observé outre-Atlantique.
« L’économie de la zone euro stagne globalement depuis la fin de l’année 2022 et a perdu beaucoup de terrain par rapport aux États-Unis ces dernières années », confirme à l’AFP Bert Colijn, économiste pour la banque ING.
Les causes de ce déclassement relatif sont nombreuses et mêlent difficultés structurelles et facteurs conjoncturels. Dans un article intitulé « Les Européens s’appauvrissent », le Wall Street Journal résumait il y a quelques mois les faiblesses du Vieux continent, caractérisé selon lui par « une population vieillissante, qui préfère le temps libre et la sécurité de l’emploi aux revenus ». Ce qui « a marqué le début d’années de croissance économique et de productivité médiocres », avant que les crises du Covid-19 et la guerre en Ukraine ne viennent « aggraver des maux qui s’envenimaient depuis des décennies », d’après le quotidien. Un constat globalement partagé par les économistes.
Un soutien budgétaire américain massif
Dans la période récente, la capacité de l’administration américaine à soutenir massivement et rapidement son économie face aux chocs a contribué à creuser le fossé entre les États-Unis et l’Europe.
« Il faut rappeler que la politique budgétaire américaine est extrêmement expansionniste. On a la politique budgétaire la plus expansionniste depuis bien longtemps », observe sur BFM Business Dany Lang, enseignant chercheur en économie à l’Université Sorbonne Paris-Nord.
En témoigne la réponse de la Maison Blanche face à la crise Covid en 2021: un plan de sauvetage colossal de 1.900 milliards de dollars prévoyant, entre autres, le versement de chèques aux ménages. Un an plus tard, le gouvernement américain dégainait l’Inflation Reduction Act (IRA), un autre plan qui, comme son nom ne l’indique pas, repose sur l’octroie de 370 milliards de dollars de subventions sur dix ans pour développer l’industrie verte.
D’après une étude de la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie, l’enveloppe consacrée à l’IRA devrait être bien plus conséquente que prévu, compte tenu des annonces faites sur la mise en œuvre du plan. L’école de commerce, qui compte parmi les plus prestigieuses du monde, l’estime désormais à 1.045 milliards de dollars. De quoi stimuler fortement l’économie américaine.
« On a une relance directe des infrastructures. Ils sont en train de reconstruire des usines partout. (…) C’est le grand paradoxe de l’administration Biden: elle risque de ne pas être réélue alors que les résultats économiques sont excellents », souligne Dany Lang.
Une efficacité européenne moindre dans le déploiement des aides
Si les États-Unis peuvent dépenser autant pour soutenir leur économie, c’est principalement grâce au fameux « privilège exorbitant » du dollar qui leur permet de faire exploser leur dette sans que cela inquiète outre mesure les marchés financiers. « Il y a une croissance achetée à crédit aux États-Unis », relève Philippe Crevel, économiste, fondateur de la société d’études et de stratégies économiques Lorello Ecodata.
Le déficit public américain atteint ainsi plus de 6% du PIB aujourd’hui, contre un peu plus de 3% en zone euro. Le ratio dette/PIB s’élève pour sa part à plus de 120% outre-Atlantique, contre moins de 90% en zone euro.
Malgré cela, l’Europe ne dispose pas des mêmes marges de manœuvre, les investisseurs ayant « plus confiance dans les États-Unis » que dans une zone qui reste « divisée » à bien des égards, rappelle Philippe Crevel. Raison pour laquelle l’UE est davantage contrainte dans ses dépenses et se doit de faire preuve d’un minimum de sérieux budgétaire pour convaincre les investisseurs. Un impératif qui a conduit les 27 a signé un accord fin 2023 sur le rétablissement de règles pour réduire les déficits publics au sein du Vieux continent.
L’Union européenne n’est pas pour autant restée les bras croisés face aux subventions astronomiques déversées outre-Atlantique. Après un plan de relance post-Covid de 750 milliards d’euros, elle a rétorqué à l’IRA américain en dévoilant le Green Deal, un plan industriel pour relancer la compétitivité de l’industrie neutre en carbone. Mais ces plans successifs peinent à avoir un impact aussi rapide et puissant sur l’économie que l’IRA américain.
« Une des différences avec le Green Deal européen, c’est la rapidité de l’obtention des sommes aux États-Unis. Vu que c’est géré au niveau européen ici, on est toujours en retard, c’est toujours très lent », constate Nathalie Janson, professeure à Neoma Business School.
C’est en effet le fonctionnement même de l’Union européenne qui peut lui être préjudiciable en période de crise. En l’absence d’union des marchés des capitaux ou d’union budgétaire, les États membres sont parfois amenés à répondre aux chocs -face à l’inflation par exemple- avec des plans nationaux d’ampleur différente, selon la situation financière de chacun, et sans grande cohérence d’un pays à l’autre.
Même quand la réponse européenne se veut commune, comme lors de la pandémie, la divergence des intérêts de chaque État membre a tendance à en atténuer l’efficacité. « Aux États-Unis, il y a un marché des capitaux unique et un État fédéral unique, alors que l’Europe, elle, n’est pas une zone totalement intégrée. La mise en œuvre de politiques y est toujours plus compliquée et avec des effets moindres, parce qu’il faut faire du saupoudrage. Le système européen est moins efficace mais il n’y a pas de consensus pour aller vers plus de fédéralisme », souligne Philippe Crevel.
L’Europe plus exposée à la crise énergétique
Pour le Wall Street Journal, les gouvernements européens n’ont pas apporté les réponses adéquates face à la crise inflationniste. « Pour préserver les emplois, ils ont orienté leurs subventions principalement vers les employeurs, laissant les consommateurs sans réserve de liquidités lorsque survenait le choc des prix », tandis que les Américains ont été incités à dépenser avec des chèques et « ont bénéficié d’une énergie bon marché », peut-on lire dans le quotidien.
Il faut dire que les États-Unis n’ont pas été exposés à la crise énergétique comme l’UE l’a été.
« La croissance américaine repose aussi sur son positionnement économique. C’est un état pétrolier. Ils vendent du gaz. lls sont avantagés par rapport à l’Europe », explique Philippe Crevel.
Sur la voie de l’indépendance énergétique, la première puissance mondiale a non seulement été épargnée par la flambée des prix mais elle a même consolidé ses parts de marché en fournissant le Vieux continent en gaz naturel liquéfié (GNL) pour compenser le recul progressif des importations de gaz russe.
De leur côté, les entreprises et ménages européens ont vu leurs factures énergétiques exploser. Moteur de l’UE, l’Allemagne a tout particulièrement souffert de cette situation, et notamment son secteur industriel, qui représente environ 20% de la richesse produite outre-Rhin. Un choc qui s’est soldé par une entrée en récession pour la première puissance économique du continent.
L’Europe plus sensible au resserrement monétaire
Une économie en surchauffe, dopée par le déversement d’argent public, d’un côté de l’Atlantique. Des ruptures de chaînes d’approvisionnement et une crise énergétique de l’autre. Les États-Unis et l’Europe, pour des raisons diverses, ont tous deux été confrontés à une forte inflation dans la foulée de la crise sanitaire. En réaction, la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne ont amorcé une phase de resserrement monétaire en 2022 avec des hausses successives de leurs taux d’intérêt.
En zone euro, l’action des banques centrales s’est traduite par une contraction du crédit qui a pesé sur l’investissement et la consommation des entreprises comme des ménages. Aux États-Unis en revanche, cette hausse de taux n’a ni affecté la croissance, ni le marché de l’emploi, alors que tout le monde prédisait qu’il n’y aurait pas de ralentissement des prix sans ralentissement d’activité.
« Ça tient quasiment de la magie, du miracle. Historiquement, c’est quelque chose qu’on a jamais vu dans de telles proportions. C’est un atterrissage en douceur. (…) C’est remarquable de voir qu’une économie peut tenir face à un choc monétaire pareil », analyse sur BFM Business Frederik Ducrozet, responsable de la recherche macroéconomique chez Pictet Wealth Management.
« La surprise, ce sont les États-Unis, pas l’Europe », affirme Philippe Crevel, qui précise tout de même que si la zone euro subit davantage la remontée des taux, c’est parce qu’elle y est « plus sensible », sachant que « le financement des entreprises en Europe se fait plus par crédit, alors qu’il se fait davantage par fonds propres aux États-Unis ».
Des consommateurs aux comportements opposés
Cette performance économique, les États-Unis la doivent avant tout aux consommateurs, certes fortement soutenus par l’État. Là-bas, en dépit de l’inflation, « les ménages ont consommé leur épargne Covid, ont fait marcher leurs cartes bancaires pour pouvoir continuer de consommer alors même que dans la zone euro, les pertes de pouvoir d’achat se sont immédiatement matérialisées par une baisse de la consommation », note Isabelle Job-Bazille, directrice des études économiques du groupe Crédit Agricole.
« Le consommateur américain consomme, quand le consommateur européen épargne 2 à 3 points de plus que par rapport à l’avant crise sanitaire », abonde Philippe Crevel.
Le taux d’épargne des ménages en Europe a effectivement progressé ces dernières années pour s’établir à 15% du revenu disponible (autour de 18% en France), tandis que celui des Américains, à moins de 4%, est plus faible que celui observé avant la pandémie. Un écart colossal qui se traduit dans les chiffres de consommation, laquelle tend à ralentir nettement en zone euro alors qu’elle ne cesse de progresser outre-Atlantique, au point d’être supérieure de 10% à son niveau de fin 2019 au 3e trimestre 2023.
Une démographie plus dynamique outre-Atlantique
Parmi les facteurs structurels qui peuvent expliquer l’écart grandissant entre l’économie américaine et l’économie européenne figure la démographie. La « démographie américaine est plus dynamique », assure Philippe Crevel. Non seulement le taux de fécondité aux États-Unis est supérieur à la moyenne européenne mais l’immigration économique progresse également.
Résultat, la population active continue d’augmenter aux États-Unis tandis que la zone euro pâtit du vieillissement démographique et voit sa population active stagner voire à diminuer. Dans une chronique publiée dans Les Échos, le conseiller économique de Natixis, Patrick Artus, indiquait que « la population en âge de travailler va continuer d’augmenter de 0,5% par an » entre 2020 et 2050 aux États-Unis, alors qu’elle diminuera « de 0,2% par an dans la zone euro ».
La semaine dernière, le président de la Fed, Jerome Powell, s’est félicité de voir que « l’offre de main-d’œuvre s’est améliorée, grâce à une plus forte participation des travailleurs âgés de 25 à 54 ans et à une augmentation de l’immigration qui a retrouvé son niveau d’avant la pandémie ».
Un marché du travail américain plus flexible
Si le taux de chômage baisse en zone euro, à 6,4% fin 2023, les performances américaines en la matière sont encore plus remarquables. Après avoir été torpillé par la crise du Covid-19, le marché du travail outre-Atlantique s’est rapidement redressé. Le taux de chômage s’y établit aujourd’hui à 3,7% de la population active et les créations d’emplois restent particulièrement dynamiques.
« En Europe, il y a une certaine rigidité de l’emploi mais le système est plus protecteur. Aux États-Unis, on préfère indemniser les chômeurs sur une courte période et permettre aux employeurs de licencier plus facilement », explique Philippe Crevel.
Pour lui, le système européen est « frappé d’inertie » et ne « favorise pas la concurrence ». Il y a quelques mois, le fondateur de Lorello Ecodata décrivait une Europe où « les entreprises, face à la pesanteur de la réglementation et aux problèmes d’image, hésitent à licencier et à créer des emplois » et où le chômage baisse « avant tout en raison de la baisse de la population active et des besoins générés par le vieillissement démographique ».
A contrario, le système américain, bien que plus vulnérable en période de crise, permet au marché du travail de s’adapter rapidement lorsque l’activité repart. « La création d’emplois y est facile tout comme celle d’entreprises » et l’intégration de l’immigration économique est efficace, relevait encore l’économiste.
Ce dernier rappelle que le filet social européen plus protecteur a su jouer son rôle pendant la crise sanitaire en évitant des faillites en cascade et des centaines de milliers de licenciements. Mais cela a aujourd’hui « un effet négatif sur la croissance car on a laissé des entreprises peu viables encore en activité », tandis que les États-Unis les ont laissées disparaître, confiant au processus de destruction créatrice le soin de les remplacer par des entreprises plus productives et innovantes.
L’inquiétante chute de la productivité en Europe
C’est peut-être l’indicateur le plus préoccupant et le plus révélateur des difficultés européennes: la chute de la productivité observée ces dernières années, alors qu’elle repart aux États-Unis. « La productivité baisse en zone euro. C’est évidement un sujet d’inquiétude majeur pour l’Europe », explique Philippe Crevel, qui alerte sur « l’écart phénoménal » qui se creuse depuis un moment avec les États-Unis:
« La productivité a crû de 10 à 12% en 20 ans en zone euro, contre plus de 40% outre-Atlantique. »
Dans une étude publiée en décembre dernier, le Conseil d’orientation des retraites soulignait que le décrochage des niveaux de productivité européens relativement aux États-Unis a débuté au milieu des années 1990, la productivité de la zone se situant aujourd’hui environ à 20% en deça de celle observée de l’autre côté de l’Atlantique.
Parmi les explications avancées: « l’effet de l’augmentation des taux d’emploi » en Europe mais également les « régulations fortes, préjudiciables aux innovations et à l’utilisation des technologies de pointe ». Il faut aussi mentionner le niveau d’investissement des États-Unis qui consacrent 3,5% de leur PIB aux dépenses de recherche et développement, contre environ 2% en Europe.
Pour Eric Chaney, conseiller économique à l’Institut Montaigne, l’écart de productivité entre Américains et Europeéns pourrait davantage se creuser dans les années à venir avec le développement de l’intelligence artificielle « qui commence à se diffuser dans l’économie » outre-Atlantique.
« C’est ce qui pourrait faire une différence phénoménale entre les pays qui adoptent l’intelligence artificielle de manière intelligente, c’est-à-dire que tout le monde s’en sert mais pas pour supprimer des offres d’emploi, et ceux qui ne le feront pas », estime l’économiste.
Il rappelle au passage les orientations différentes prises par l’UE et les États-Unis sur ce sujet: « La position européenne est une position qui consiste à se protéger des excès de l’IA, alors que la position américaine est d’y aller à fond ».
[ad_2]
Source link