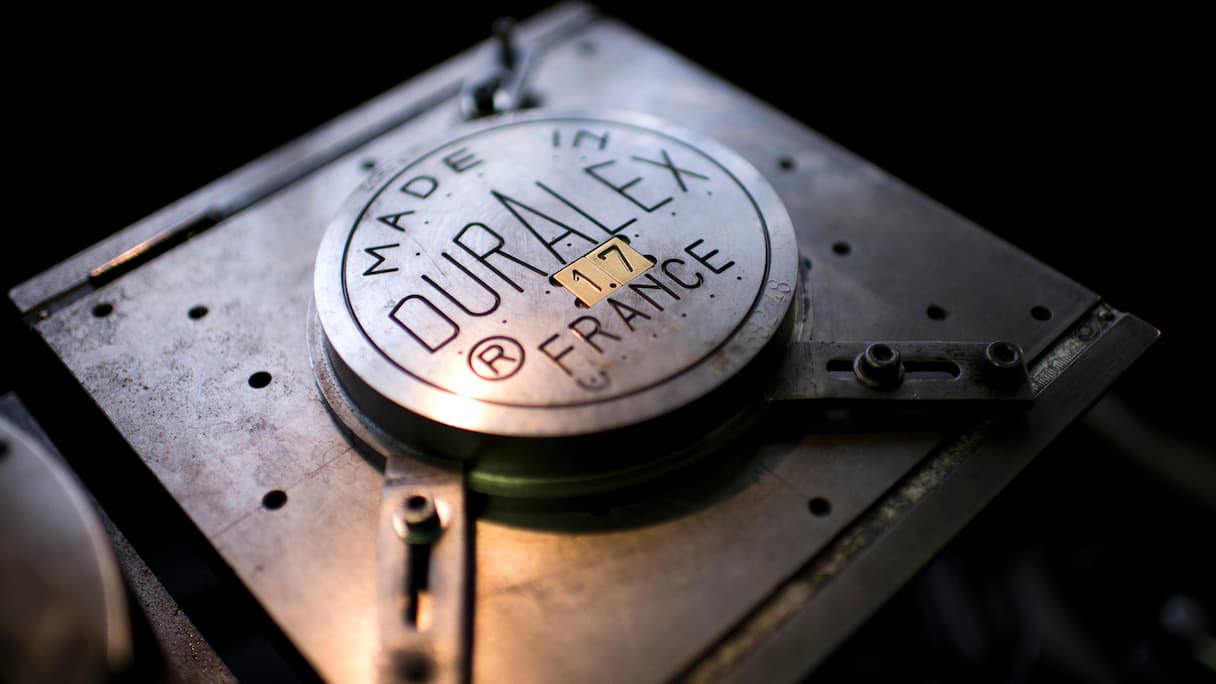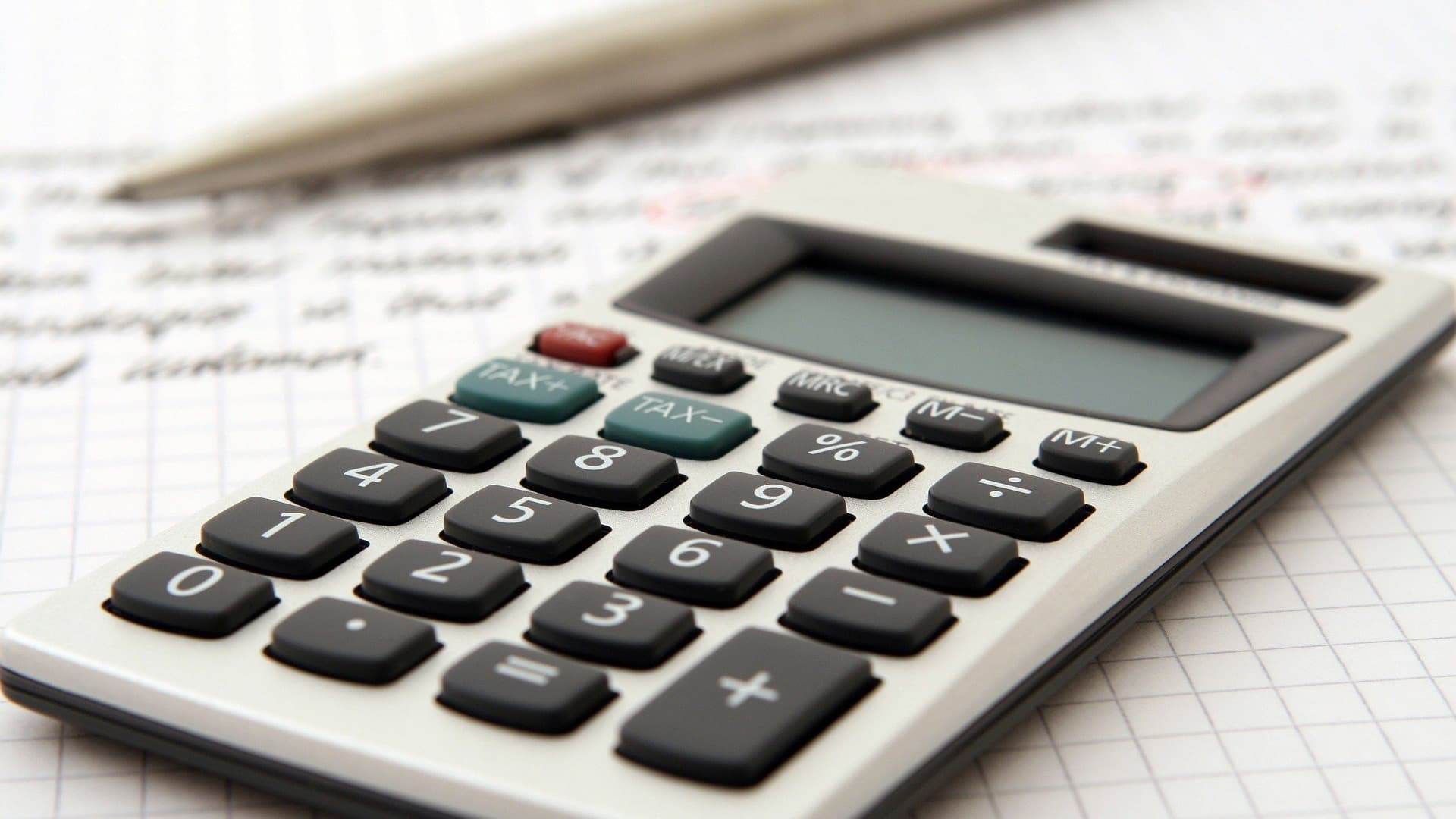[ad_1]
L’Afrique de l’Ouest retient son souffle. La Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) a décidé jeudi soir le déploiement de sa « force en attente » pour rétablir l’ordre constitutionnel au Niger. Des troupes nigérianes, ivoiriennes et béninoises pourraient notamment composer cette force qui entend déloger les putschistes et réinvestir le président élu Mohamed Bazoum.
Alors que Bola Tinubu , président du Nigeria – l’Etat le plus puissant de la région – espère encore « parvenir à une résolution pacifique », Alassane Ouattara, à la tête de la Côte d’Ivoire, a annoncé que les soldats de la Cedeao pourraient intervenir « dans les plus brefs délais ». La Cedeao n’en serait pas à son coup d’essai. S’émancipant de sa raison d’être économique, l’alliance est en effet déjà intervenue militairement plusieurs fois depuis les années 1990 pour rétablir l’ordre dans la région.
· Interposition au Liberia (1990-1999 puis 2003)
En 1990, la Cedeao crée l’Ecomog (Economic Community of West African States Cease-fire Monitoring Group), dirigée par le Nigeria, pour stopper la guerre civile qui fait rage au Liberia. La force d’interposition compte jusqu’à 20.000 soldats, baptisés les « casques blancs », qui mettent sept ans à ramener la paix. Leur passage au Liberia leur a aussi valu des accusations de violation des droits de l’homme.
En 2003, une nouvelle mission est envoyée à Monrovia, la capitale, assiégée par des rebelles. Le contingent, restreint, ne parvient pas à assurer le contrôle du pays et est suppléé par l’ONU.
· Déploiement au Sierra Leone (1997-2000)
Après le Liberia, l’Ecomog intervient en Sierra Leone, aussi en proie à une guerre civile. La junte est chassée et le président déchu Ahmad Tejan Kabbah est rétabli au pouvoir.
· Interventions en Guinée-Bissau (1999)
En 1999, l’Ecomog est déployée en Guinée-Bissau pour rétablir l’ordre après une tentative échouée de coup d’Etat qui a dégénéré. Mais les « casques blancs » ne parviennent pas à empêcher le renversement du président.
De 2012 à 2020, les soldats de la Cedeao ont participé à une mission de pacification dans le pays. Un contingent de quelques centaines de soldats a également été envoyé en Guinée-Bissau en 2022 pour stabiliser le pays après un coup d’Etat manqué.
· Maintien de la paix en Côte d’Ivoire (2003)
En renfort de la mission française Licorne et des « casques bleus », les 1.300 hommes de la Cedeao font respecter le cessez-le-feu entre les forces armées régulières et des groupes rebelles, qui tiennent le nord du pays.
· Opération antidjihadiste au Mali (2013)
Les groupes djihadistes, qui contrôlent alors le nord du Mali , menacent le reste du pays et sa capitale Bamako. Conformément à une résolution de l’ONU, la Cedeao dépêche une force d’intervention pour soutenir l’armée malienne, aux côtés des militaires français de l’opération Serval.
· « Restaurer la démocratie » en Gambie (2017)
Alors que le président gambien Yahya Jammeh, battu après 22 ans à la tête de l’Etat, refuse de quitter le pouvoir, la Cedeao lance l’opération « Restaurer la démocratie ». La mission est suspendue au bout de quelques heures pour laisser une dernière chance aux pourparlers : Yahya Jammeh est contraint d’abdiquer.
Fracture régionale
Si la Cedeao est habituée aux déploiements de troupes dans la région, l’éventualité d’une intervention au Niger dans les prochains jours divise : les juntes maliennes et burkinabées soutiennent les putschistes au Niger, partageant avec les nouveaux maîtres de Niamey des accointances avec le groupe paramilitaire russe Wagner et un même rejet de la présence française en Afrique.
Dans un communiqué daté du 1er août, les autorités de la Guinée , menées par le colonel Mamadi Doumbouya, se sont aussi désolidarisées des sanctions prises par la Cedeao et ont affirmé leur solidarité avec « les peuples frères » du Niger, du Mali et du Burkina Faso. L’Algérie, qui partage 950 kilomètres de frontières avec le Niger, est aussi vent debout contre toute intervention, disant redouter que toute la région ne s’embrase.
[ad_2]
Source link