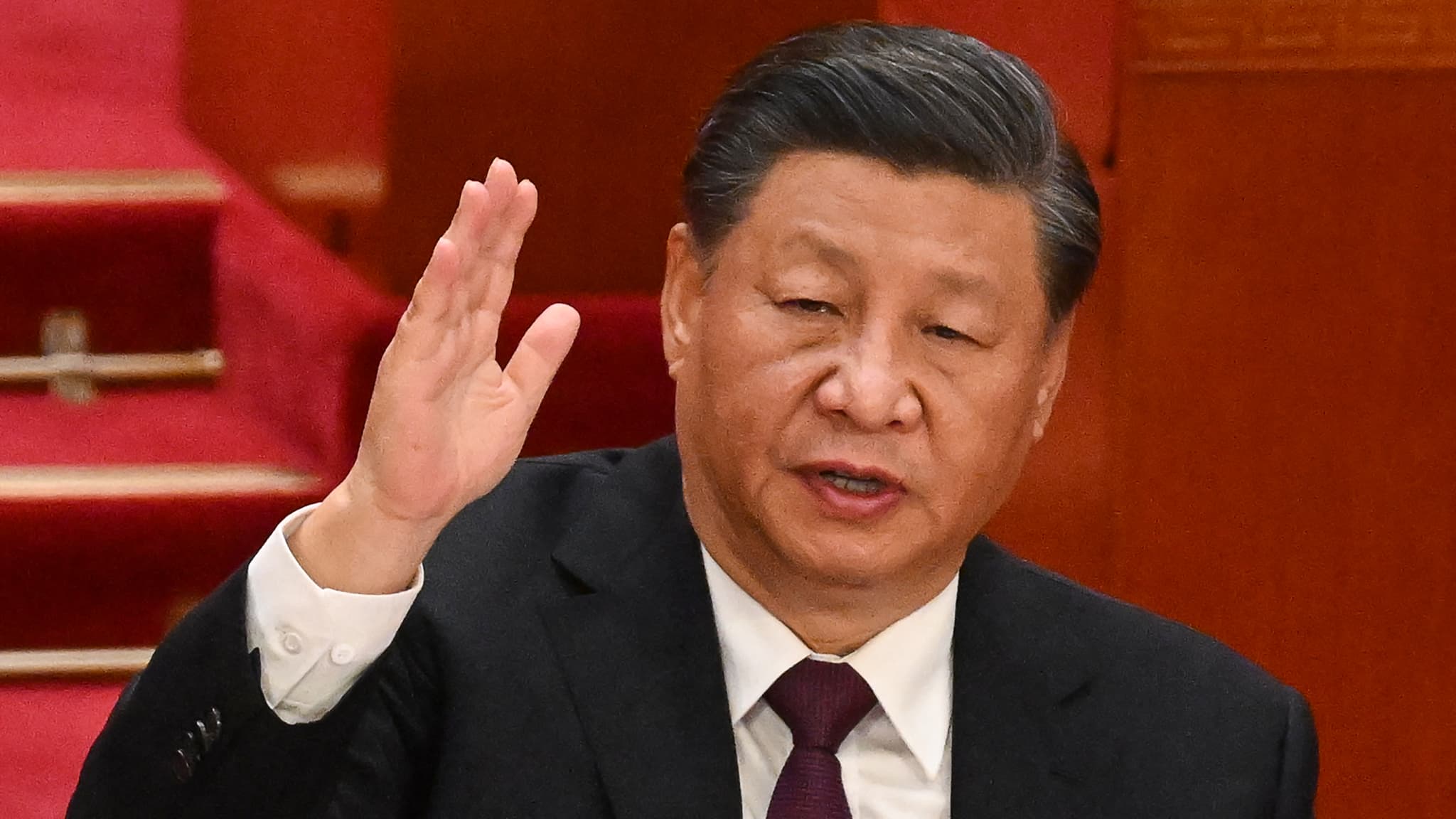[ad_1]

44 ans, elle a la détermination de ceux qui ont un parcours hors du commun. L’enfance d’Aya Cissoko est jalonnée de drames familiaux. Elle est ensuite devenue une sportive d’exception : championne du monde en boxe française puis anglaise. Reconversion réussie, elle fait Sciences-Po puis se met à l’écriture avec un certain succès. C’est la rage au ventre qu’elle a traversé les épreuves. Elle nous reçoit dans un square près de chez elle, dans le 14e arrondissement de Paris.
La révolte de ces jeunes gens est légitime. C’est une question de dignité. Tout le reste n’est que palabre. Cela fait des années que nous crions notre oppression. Je suis quotidiennement sur le terrain avec les adolescents. J’anime des ateliers d’écriture et je suis l’un des baromètres de ce qu’ils peuvent ressentir. Leur réalité est juste inhumaine. Encore une fois, la réponse du gouvernement passe par la répression. Ceux qui osent exprimer leur colère vont aller en prison à cause des manquements institutionnels, du racisme qui structure la police. Rien ne change. Ce harcèlement, mon frère l’a subi, j’en ai été témoin. J’ai vécu dans l’une des pires cités de Paris, le 140 rue de Ménilmontant. Aujourd’hui, j’ai peur pour mes neveux. Parce qu’ils sont adolescents, noirs et qu’ils vivent en banlieue.
Cette dignité revient tout le temps dans votre parcours. Vous avez écrit avec Marie Desplechin « Danbé », qui veut dire « dignité » en bambara…
Ce que je dis dans mon dernier ouvrage, c’est que quiconque n’a pas eu sa dignité mise en jeu ne peut pas savoir vraiment ce que c’est. Tous ces politiques qui osent en parler, qui n’ont jamais eu à lutter pour la garder ne savent pas de quoi ils parlent. Mes livres expliquent à quel point l’arbitraire commande nos vies. À aucun moment, que ce soit mes parents ou moi-même n’avons pu véritablement faire le choix de nos parcours. C’est la nécessité qui a conduit mon père à venir s’installer ici dans les années 1960. La France avait colonisé le Mali. Il savait que les usines embauchaient. Il a été ouvrier chez Renault, puis dans le bâtiment, sans jamais choisir son métier. On ne décide pas des lieux où l’on va habiter, des écoles que l’on va fréquenter. Notre société est hiérarchisée et le Blanc reste la norme. Il commande nos vies, même sur le continent africain. C’est une mainmise qui ne quitte jamais les corps non blancs.
C’est pourquoi ne pas faire de compromission avec notre dignité demeure une lutte du quotidien.
Selon vous, le racisme est institutionnel ?
Bien évidemment. C’est un non-sujet. La question, c’est comment réussir à neutraliser cette société de prédation de nos corps, de nos vies, de nos rêves. C’est d’arriver à ce que chaque individu puisse enfin se dire qu’il est un citoyen à part entière.
Quand vous êtes-vous rendu compte des discriminations sociales, raciales ?
Très tôt. Mais quand on est enfant, on n’a pas les mots. Vu la violence avec laquelle le malheur a frappé les miens, je n’ai pas eu le temps de théoriser. Ma trajectoire est jalonnée de drames qui me disent que nos vies valent beaucoup moins que celles d’autres individus. Mon père et ma petite sœur ont été assassinés dans un incendie criminel, raciste, revendiqué par un groupuscule d’extrême droite, alors que je n’avais que 8 ans. Personne n’a été mis dans le box des accusés. Mais l’institution s’est-elle donné les moyens de trouver les coupables ? Moins d’un an plus tard, mon petit frère est mort d’une méningite. Alors que ma mère l’avait amené à l’hôpital, les médecins lui ont dit de rentrer chez elle avec de l’aspirine. Femme de ménage, elle a cumulé plusieurs contrats pour que ses enfants ne manquent de rien. On lui a pourtant renvoyé l’image d’une mère négligente. Elle s’est tuée à la tâche et est morte prématurément, à 55 ans. Aujourd’hui, des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants périssent en Méditerranée alors qu’ils pourraient être sauvés. On accepte beaucoup plus facilement le malheur pour ceux qui sont tout en bas de la hiérarchie sociale. Alors que ce qui devrait nous guider, ce sont les vies humaines. Et non, une vie ne vaut pas plus qu’une autre.
Vous dites avoir eu honte de votre mère qui arrivait du Mali, analphabète…
Lorsque vous êtes enfant et que continuellement, on vous fait comprendre que vous n’êtes pas la norme, que vous ne parlez pas la même langue, que vos parents ne s’habillent pas de la bonne manière, vous voulez faire partie du camp des plus forts. Ça a été mon premier réflexe. Puis j’ai grandi. J’ai commencé à observer et prendre du recul. Et j’ai compris. Mes livres, c’est aussi une histoire de réparation. C’est choisir mes héros et mes héroïnes. Et ce ne sont pas celles et ceux que l’on donne à voir, à entendre. Ils sont les miens. Celles et ceux qui m’entourent. Bien évidemment, il y a ma famille. Mais aussi des individus qui s’investissent dans l’humain – l’assistante sociale, l’instituteur, le prof de sport… Car ce sont ces individus qui sauvent. Pas l’institution.
Pourquoi, enfant, avez-vous choisi de pratiquer
la boxe ?
J’y suis arrivée par hasard. Un enseignant proposait des cours de boxe française. Ce n’est pas un sport que j’ai vraiment aimé. Qui est fait pour donner et prendre des coups ? Il y a des raisons personnelles, impérieuses qui font que l’on pratique ce sport. Il me manquait les mots pour exprimer ce que je vivais au quotidien. C’était un moyen pour ne pas faire du mal, à moi et à ceux qui m’entourent. Pendant longtemps, j’ai eu besoin de la boxe. Il a fallu que je me blesse – une fracture des cervicales – pour que je m’arrête. Que je commence à réfléchir sur la vie qui a été la nôtre et que je comprenne les raisons de ma colère.
En 2008, vous entrez à Sciences-Po, qui ouvre alors ses portes aux sportifs de haut niveau. Quel a été le déclic ?
J’avais la certitude que je reprendrais mes études. En même temps, j’étais hésitante. Sciences-Po, quand on vient d’un quartier populaire, on en entend parler de très loin et on se dit que ce n’est pas pour nous. Lorsque je me suis retrouvée dans le bureau du recruteur, il m’a parlé d’une manière qui déclenche le oui, en piquant l’ego de la sportive. J’avais 28 ans. J’ai été frappée par l’aisance des jeunes élèves, pour qui tout avait toujours été facile. J’y ai aussi rencontré des professeurs extraordinaires. Je me dis que si tous les enfants pouvaient profiter des moyens matériels et humains dont bénéficient les étudiants de Sciences-Po, tout tournerait bien mieux.
Après « Danbé », vous avez écrit « N’ba », en hommage à votre mère, puis « Au nom de tous les tiens », adressé à votre fille. Qu’est-ce que ça veut dire pour vous, mettre des mots ?
Je souhaitais laisser une trace. Car le propre de ces sociétés occidentales, blanches, a été d’effacer les Noirs de la narration. J’ai voulu prendre le contre-pied. Donner d’autres perspectives aux enfants, pour leur rendre l’estime qu’ils portent aux leurs, à eux-mêmes. Leur dire, comme me répétait ma mère : « Tu n’es pas l’enfant de rien ni de personne. » Tu t’inscris dans une histoire, une filiation.
Quel lien pouvez-vous faire entre l’écriture et la boxe ?
Je suis un être d’émotions, entière. « N’ba » et « Au nom de tous les tiens », je les ai écrits avec mes tripes, comme je boxe. Il faut que ça sorte car le chagrin, la rage me bouffent. Il y a urgence. La boxe est conçue comme un sport où l’on est censé canaliser. Mais non, la colère se transmet de génération en génération et il faut qu’elle s’exprime. Quand les jeunes pourront mettre des mots et comprendre les raisons de leur colère, ils n’auront plus besoin de casser. La balle est dans le camp des institutions. Cela fait des décennies qu’on leur explique et qu’ils n’entendent pas.
Avec Omar Sy, Zinedine Zidane et quelques autres, vous êtes souvent présentés comme symbole de la méritocratie. Quand on veut, on peut ?
C’est une approche très capitaliste : parce que vous avez performé, vous méritez. Il va falloir rompre avec ça, d’autant que nous ne partons pas tous du même niveau. Une fois de plus, on nous fait croire que nous sommes les seuls responsables de nos trajectoires. Ce qui annihile toute révolte. Pourtant, la colère est justifiée. Elle est saine. C’est une pulsion de vie. Elle dit : « On existe. Nous n’avons pas encore renoncé. Parce que vous ne nous en donnez pas le choix. » Quand nous aurons le droit d’être juste quelqu’un de normal, de médiocre, alors nous aurons vraiment atteint l’égalité.
[ad_2]
Source link